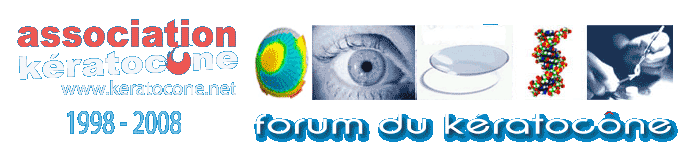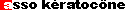Le Pr Yves Pouliquen qui nous a approché récemment, compte sur le soutien de l’association pour aider le Pr Malcaze dans sa recherche sur les causes génétiques du kératocône. Depuis quelques années nous sommes en contact avec l’Unité Inserm de CHU de Purpan (Toulouse) qui vient de localiser dans l’ADN, l’agent causal du KC. Le travail considérable de cette unité de recherche a mis en évidence une « trace » génétique dans le chromosone 2. Une étude complémentaire doit confirmer cette découverte afin d’identifier le gène responsable du KC. A plus ou moins long terme, une thérapie génique n’est pas exclue. Ce qui signifierait un traitement définitif de cette maladie.
Une étude nationale sera mise en place prochainement. Le Pr Malcaze et notre Comité Scientifique préciseront prochainement un protocole pour mener à bien cette recherche. Bien entendu, ce sera le thème principal de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu à Paris le 5 février prochain. Le Pr Malcaze sera présent pour répondre à vos questions.
Amitiés
Anne
Localisation et clonage positionnel du (des) gène(s) du kératocône familial isolé
Le kératocône est une maladie de la cornée fréquente (1 à 4 cas pour 2000 personnes), débutant à l’adolescence en général, qui touche essentiellement les adultes . Son nom est dû au fait qu’elle provoque une déformation progressive de la cornée, qui, de sphérique devient cônique, et perd ainsi une partie de ses qualités optiques. Il en résulte un handicap visuel plus ou moins rapidement progressif qui dans beaucoup de cas peut être corrigé par le port de lunettes puis de lentilles adaptées. Cependant, dans certains cas, l’évolution qui se fait sur un mode lentement progressif conduit à réaliser une greffe de cornée. Cette intervention reste lourde et le résultat fonctionnel en terme d’acuité visuelle est aléatoire, notamment du fait de la myopie et/ou l’astigmatisme résiduel post-opératoire et du risque de rejet qui est maximal durant les premiers mois après le geste chirurgical.
Dans le monde scientifique, Il était communément admis, d’après les travaux réalisés depuis le début du 20eme siècle, que seulement 10% des kératocônes étaient des formes familiales et donc probablement d’origine génétique. Plusieurs études récentes, publiées en 2000 et 2001, réalisées avec des moyens de détection de formes à minima de kératocône, qui passaient inaperçues auparavant, suggèrent qu’ en fait au moins 40% des kératocônes seraient liés à une anomalie génique. Ainsi, chez les apparentés de kératocône (frère, sœur, parents, enfants) la probabilité d’être atteint serait 15 à 67 fois supérieure à celle observée dans la population générale .Cette piste génétique a conduit plusieurs équipes américaines et européennes, dont la notre, à se lancer avec le soutien actif d’associations de malades dans la course à la découverte du gène impliqué dans les formes familiales de cette affection cornéenne. En effet, la découverte de l’anomalie génétique responsable de cette maladie aurait des conséquences considérables dans le domaine de la cornée. Elle permettrait de mieux caractériser et dépister les formes débutantes, de préciser le mécanismes d’apparition de cette affection et à plus long terme de mettre en place des stratégies thérapeutiques visant à freiner l’évolution de cette pathologie et éviter la greffe de cornée qui est actuellement le seul recours pour le kératocône avéré.
Notre projet, initié il y a 3 ans, a d’abord consisté à recruter de nombreuses familles de kératocône à travers la France et une partie de l’Europe, créant une banque d’ADN de issus de nombreux patients volontaires et de leur entourage familial, dans des familles comportant 2 kératocônes avérés. Ce premier travail a permis de mieux préciser les caractéristiques cliniques des kératocônes débutants en analysant très finement la forme des cornées de nombreux apparentés apparemment sains dans les familles atteintes. Ces découvertes ont donné lieu à une publication scientifique dans un article de la revue Ophthalmology , organe de référence de la société américaine d’ophtalmologie en mai 2004 (1). Ce travail constitue une avancée dans la détection des formes peu sévères de la maladie et permet de mieux « étiqueter » les patients sains et malades, ce qui est un préalable indispensable à toute étude de liaison génétique.
La première partie des tests génétiques effectuées sur plus de 180 membres de 23 familles atteintes du kératocône familial nous a permis de mettre en évidence une région du chromosome 2 contenant un gène responsable du kératocône. Ces résultats vont être publiés très prochainement dans une revue internationale de référence en génétique (2). Il faut souligner que la présence du gène anormal ne se traduit pas toujours par l’expression de la maladie car des mécanismes de compensation existent, ce qui est une chance pour le porteur, mais complique l’interprétation des résultats, car un sujet qualifié de sain peut porter le gène anormal.
Par la poursuite laborieuse de ce travail de biologie moléculaire, la région chromosomique de grande taille au départ, a été réduite à une petite zone d’environ 50 gènes qui devrait contenir au moins le gène anormal. Malheureusement, la zone suspecte, ou se trouve très certainement le gène responsable , n’est pas encore séquencée, ce qui signifie que les gènes de cette région n’ont pas encore tous été découverts par les généticiens qui travaillent dans le monde entier pour décoder tous l’ensemble des gènes de l’ADN humain (comme le projet Genethon ). La petite zone qui nous intéresse donc n’est pas cartographiée, et nous avançons donc péniblement dans une zone inconnue.
Loin de nous décourager si prés du but, nous poursuivons le séquençage des gènes de cette petite région, afin de découvrir quel est le gène de cette région qui est défectueux en comparant pas à pas, minutieusement, au sein des familles, maintenant l’ADN de patients et l’ ADN des apparentés sains.
Pour accélérer la découverte du gène muté de cette région, nous venons de mettre en place une étude de déséquilibre de liaison, stratégie qui a permis tout récemment de mettre en évidence un gène prédisposant à l’infarctus du myocarde. Le principe est de comparer l’ADN d’une population d’au moins 200 kératocônes sporadique (survenant de façon isolée) ou familial à une population de témoins sains dont l’âge et l’origine ethnique et géographique sont comparables. Ce type d’étude nécessite une collaboration large entre plusieurs centres, et le soutien actif d’associations de patients car plusieurs centaines de sujets sont requis pour espérer aboutir à un résultat. Cette stratégie devrait nous permettre de repérer avec plus d’exactitude la portion où se trouve le gène muté responsable du kératocône.
En conclusion, l’identification du ou des gènes du kératocône constituerait un résultat majeur dans la prévention et la thérapeutique de cette maladie de la cornée. L’application principale et immédiate serait la possibilité d’offrir un outil de dépistage précoce, par prélèvement sanguin, pour les membres des familles dont un membre est atteint , avec une marge d’erreur réduite.
Ce test de dépistage s’appliquerait aussi aux patients désireux de bénéficier d’une chirurgie réfractive cornéenne, car dans ce cas , la présence d’un kératocône très minime constitue une contre indication absolue (risque d’aggravation du kératocône) et pour l’heure aucun moyen de détection n’est satisfaisant.
Dans le domaine thérapeutique, de nouveaux médicaments dérivés de ces études pourraient traiter efficacement cette affection cornéenne, en remplaçant les molécules impliqués produites insuffisamment et/ou anormalement sous l’impulsion du gène défectueux. Cette approche conservatrice et plus physiologique permettrait de freiner l’évolution et peut-être d’éviter le recours à la greffe de cornée.
Références :
1. Levy D., Hutchings H., Rouland J.F., Guell J., Burillon C., Arne J.L., Colin J., Laroche L., Montard M., Delbosc B., Aptel I., Ginisty H., Grandjean H., Malecaze F., Videokeratographic anomalies in familial keratoconus, Ophthalmology, 2004; 111 (5):867-74.
2. Hutchings H., Ginisty H., Le Gallo M., Levy D., Stoësser F., Lalaux M.H., Calvas P., Roth M.P., Hovnanian A., Malecaze F., Identification of a new locus for isolated familial keratoconus at 2p24, J Med Genet, In Press.